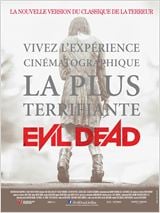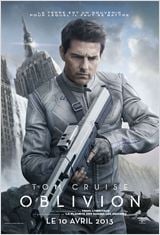Sans être un fan à proprement parler du genre
buddy movie, l'
Arme Fatale premier du nom - un peu comme
Kiss Kiss Bang Bang, quoi - bénéficie d'une belle écriture et fait montre d'un réel sens de la dramaturgie. Comme dans
Die Hard 3 - version twistée du
buddy movie - il y a dans ce premier volet un rythme assez implacable - rythme de l'histoire, rythme de la phrase - qui lui permet, tout en respectant une codification précise mais courte (une enquête, deux héros ou anti-héros qui de prime abord, s'opposent) de se différencier et de se hisser nettement au dessus du lot. En somme, c'est pas
48h ou
Rush Hour.
Après, j'ai pas l'impression que
Black ait été le choix le plus judicieux pour une production telle qu'
Iron Man. Ça me semble être assez hasardeux même, compte tenu de son parcours chaotique. Mais comme je l'ai dis et redis,
Iron Man et le reste des super-zozos, je m'en balance gentillement.
Je reviens maintenant rapidement sur un autre film.
Cloud Atlas de Tom Tykwer et des Wachowski :
 "I understand now, that boundaries between noise and sound are conventions. All boundaries are conventions, waiting to be transcended. One may transcend any convention, if only one can first conceive of doing so."
"I understand now, that boundaries between noise and sound are conventions. All boundaries are conventions, waiting to be transcended. One may transcend any convention, if only one can first conceive of doing so."
Prononcées par
Robert Frobisher, pianiste homosexuel et amoureux passionné, les phrases précitées renferment le maître-mot de
Cloud Atlas, soit le verbe
transcender. Tout comme
Matrix en son temps - et du fait des thèmes qu’il aborde - le film des frères et sœurs
Wachowski et
Tom Tykwer présente un obstacle réflexif majeur face auquel on peut aisément s’adonner à une sur-interprétation fumeuse, outrancière et,
in fine, littéralement hors de propos. L’écueil, c’est ce verbe
transcender.
De facto, l’écueil, c’est également le terme
transcendance.
Quelques considérations. Le verbe en question. Il indique un dépassement et implique un mouvement. Il y a
action et par conséquent
mouvement au-delà de. La transcendance suppose au préalable un rapport entre les êtres, rapport amené à évoluer puisque la transcendance, par l’affranchissement, créée une distanciation. Il y a action par rapport à. Un individu, une société, une institution. Nul besoin de citer les philosophes en tout genre, sous peine de partir définitivement en cacahuète – et compte tenu de mes compétences limitées en matière de philosophie, de raconter n’importe quoi. De même, ciao la
méta-mantra-pouet-pouet-philo-new-age. Si l’on s’en tient aux faits,
Cloud Atlas illustre parfaitement la transcendance. Elle est rupture, discontinuité. Transcender : les conceptions sociales, l’amour. Transcender les genres, dans une double dimension, à la fois sociologique et anthropologique.
En réfléchissant à
Cloud Atlas, j'ai soudainement pensé à
Truffaut.
Quel est le rapport ? En réalité, ce sont des paroles de
Truffaut qui me sont venues à l'esprit. Des paroles qui résonnent comme une grande affirmation dans
La Nuit Américaine. Une déclaration. La déclaration d'amour d'un cinéaste à un art, le cinéma. À travers le réalisateur
Ferrand,
Truffaut dit que
"les films sont plus harmonieux que la vie." Il dit qu'
"il n’y a pas de temps mort dans les films." De là, j'ai repensé aux différents récits de
Cloud Atlas. Prises indépendamment, les six trames narratives peuvent paraître interchangeables, parfois même relativement vaines.
Quid de cette histoire d’évasion de quatre individu placés contre leur gré dans une maison de retraite ?
Quid de cette traversée maritime ou encore de cette intrigue journalistique ? Des récits, on peut en imaginer des dizaines, des centaines d’autres. Pourquoi sinon parce qu’il s’agit simplement de tranches de vies et donc, de vies non harmonieuses. Pourtant, agglomérées en un tout, comme placées sous un dôme artistique, ces histoires individuellement permissives deviennent film de cinéma, gagnent en force et par la force du montage, gagnent en magie, masquant ainsi les fameux temps mort dont parlait
Truffaut.
Six histoires. En réalité huit histoires. La septième intégrée au sein de la sixième, où
Zachry, âgé, narre un récit à la jeune génération. La huitième traverse tout le film. C'est l'histoire du cinéma.
De la question de l'émotion. L’émotion dans
Cloud Atlas surgit de petits riens, précisément de micro-éléments des multiples récits qui donnent corps par leur adjonction à UN grand récit et lient les personnes à travers les époques et les lieux. Par un échange de regards, un couché de soleil ou la lecture d'une lettre. De retour à San Francisco après un voyage qui a failli lui coûter la vie,
Ewing rejette fermement l'esclavagisme. Son beau-père, symbole de la traite, lui dit que c'est une folie. Une décision inepte, vouée à l'échec. Précisément une
goutte d'eau dans l'océan. Ce à quoi Ewing répond très simplement,
"qu'est qu'un océan sinon une multitude de gouttes d'eau ?" Si le film est un océan, les micro-éléments provoquant l'émotion en sont les gouttes.
Evil Dead de Fede Alvarez :
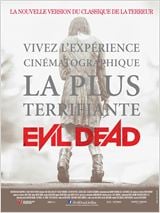 "-I will feast on your soul !
"-I will feast on your soul !
- Feast on this motherfucker !"
Ce
Evil Dead version 2013, c'est un peu comme
La Colline à des Yeux. Dans le genre remake, c'est vraiment le haut du panier. C'est dégueulasse. Voire même hyper dégueulasse par moment.
J'ai beau ne pas être très client de ce genre de film, j'étais assez curieux de voir ce que ça pouvait donner. Au final, c'est bien. Pas génial, mais bien. Un bon moment de cinéma, un peu anxiogène, un peu horrifique, bien malsain et très gore. L'histoire, je ne reviens pas dessus. Le film est plutôt bien emballé, avec une jolie photographie qui rappelle - de manière moins ostentatoire - le remake de
Texas Chainsaw Massacre de
Nispel. C'est donc fort agréable à l'oeil, mais en plus, la mise en scène tient globalement bien la route. Elle alterne entre recherches picturales très élégantes, plans faisant hommage au film initial de Raimi, et grammaire horrifique / trash traditionnelle. De l'ensemble se dégage un aspect
vintage assez agréable, assez classe et très honnête. Ce n'est pas simplement de l'épate.
Le film fonctionne bien sur la durée, à savoir une heure trente et plus d'une fois je me suis tortillé sur mon siège. L'atmosphère est malsaine, l'horreur graphique, très frontale. C'est douloureux et assez crispant. Un film avec démons, possessions et tout le bazar, ça a un côté quelque peu imprévisible. Ça laisse la place à des écarts susceptibles d'être éprouvants. Y a donc du viol, de l’automutilation et autres joyeusetés parfois très dures à supporter et ce encore plus du fait de l'orientation volontairement
réaliste de ce projet.
Evil Dead, franchement, c'est bien. C'est un bon moment de cinéma. Ça ne pète pas plus haut que son cul, ça fait bien le travail et ça en met plein la tête. Bien évidemment il y a des défauts, comme une caractérisation des personnages très légère, des enchaînements capillotractés ou encore une ou deux scènes qui pêchent sur le plan de la réalisation - une dans le dernier tiers du film en particulier - mais c'est un sentiment positif qui domine.
Alvarez, aime le cinéma, s'amuse et témoigne de sa connaissance du genre. Pour moi, c'est réussi.
Et j'ai adoré le face à face final de toute beauté.
Pour ceux qui décident d'aller le voir, restez bien jusqu'à la fin du générique.
The Grandmaster de Wong Kar-Wai :

Pas totalement convaincu par ce nouveau film de
Wong Kar-Wai. C'est même une déception. Un film hybride aux multiples facettes. Esthétiquement comme narrativement, ça part dans tous les sens. C'est l'histoire d'
Ip Man, le fameux
Grandmaster du titre, mais aussi - et surtout - l'histoire de quatre ou cinq autres personnages ou clans, dont le clan Gong.
Dans l'immédiat, je ne sais pas trop comment en parler.
Wong Kar-Wai oblige, c'est hyper esthétisé, mais là au point parfois d'être vidé de toute substance. Rien dans le film n'est vraiment homogène. C'est apparemment totalement volontaire mais personnellement, ça m'a constamment déstabilisé. Tant et si bien que je suis majoritairement resté de glace devant le film, seulement impressionné par la maîtrise du cinéaste. Et encore, là, y a matière à blablater parce que ce que tente le cinéaste est souvent très bancal. Y a de la pellicule, un grain d'image ultra variable, de la HD et des variations de vitesses ultra rébarbatives. C'est ce dernier élément qui m'a véritablement agacé. Ce freinage constant que je trouve personnellement horripilant hache les scènes et les alourdi. Et cet effet revient constamment. Pendant les combats ET pendant les dialogues. On dirait tout simplement que ça lag.
Les combats, c'est clairement pas le point fort du film. Ceux sous la pluie sont presque illisibles. Mais vraiment. À quoi ça se résume ? À une succession de gros plans d'une à deux secondes. Des mains, des pieds, un petit plan large de hauteur pour dire de et des plans en slow sur la neige, les gouttes d'eau, les tissus et j'en passe. Et c'est toujours pareil.
Franchement, je suis dégoûté. Encore plus au fur et à mesure de ces lignes. Parce que
Kar-Wai a signé un de mes films préférés, un monument hybride lu aussi mais avec lequel je suis en phase. Un film labyrinthique, hypnotique et sensuel. Un putain de chef d'oeuvre quoi.
2046. Parce que
Kar-Wai a travaillé durant cinq ans sur ce film mais qu'au final, quand bien même il s'avère par moment absolument époustouflant visuellement, on dirait un foutu
work in progress. On dirait qu'il manque au minimum un tiers de film.
Oui, parfois c'est somptueux mais c'est tout. Le film est une cathédrale vide. Le seul moment où l'on voit des personnages vivants et ou tout s'accorde, ben c'est dans les dix dernières minutes. Sur plus de deux heures de film, ça fait pas bézef.
Dégoûté je vous dis.
 ) mais les personnages sont sympas, et c'est marrant de jouer a les retrouver dans chaque époque. Eu quelques surprises en voyant le générique de fin qui les présente.
) mais les personnages sont sympas, et c'est marrant de jouer a les retrouver dans chaque époque. Eu quelques surprises en voyant le générique de fin qui les présente. effets spéciaux zéro, scenario zéro, casting zéro... J'ai tenu juste car je voulais savoir comment ça finissait, et que j'avais rien a faire.
effets spéciaux zéro, scenario zéro, casting zéro... J'ai tenu juste car je voulais savoir comment ça finissait, et que j'avais rien a faire.