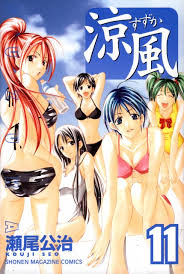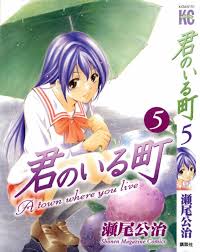Et voilà nous tenons notre premier qualifié pour les 1/4 de finale. Il s'agit de
Radiohead qui a dominé ce versus du début jusqu'à la fin, en l'emportant sur son valeureux adversaire,
Brassens,
15 voix à
11 voix.
Bravo à Radiohead qui perpétue la tradition rock du forum

.
D'ailleurs pour le versus qui nous intéresse désormais, il s'agit également d'une nouvelle opposition de style. Les papys du Rock contre le papy du baroque (enfin papy... il n'en reste plus grand chose hormis ses écrits).
*******************************************
Présentation de Jean Sébastien Bach :
Sérieux... j'ai tenté de faire court

...
Johann Sebastian Bach (parfois écrit en français Jean-Sébastien Bach) est un compositeur et organiste allemand, (21 mars 1685, à Eisenach - 28 juillet 1750, à Leipzig)
Compositeur de l'époque baroque dont il symbolise et personnifie l'apogée, il eut une influence majeure et durable dans le développement de la musique occidentale ; les plus grands compositeurs, tels que Mozart et Beethoven, reconnurent en lui un maître insurpassable.
Son œuvre est remarquable en tous points : par sa rigueur et sa richesse harmonique, mélodique ou contrapuntique, sa perfection formelle, sa maîtrise technique, sa pédagogie, la hauteur de son inspiration et le nombre de ses compositions. Elle échappe à la gradation traditionnelle avec la formation, la période de maturité puis le déclin : la qualité des œuvres de jeunesse égale celle des compositions plus tardives. Il n'est pas exceptionnel de le considérer comme le plus grand compositeur de tous les temps.
Avec Johann Sebastian, la musique baroque atteint à la fois son apogée et son aboutissement. Dès sa disparition, le musicien génial est quasiment oublié parce que passé de mode, comme le contrepoint qu'il a porté à une perfection inégalée.
Les fils qu'il a formés Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich, Johann Christian vont suivre des chemins différents que Bach avait déjà devinés en disant « Carl Philipp Emmanuel est comme le bleu de Prusse, il sera connu mais s'évaporera vite. Seul Wilhelm Friedeman réussira à percer durablement même s'il mettra du temps avant de réussir ». Se basant sur l'excellente éducation musicale inculquée par leur père, les quatre fils se lanceront vite sur la voie du courant pré-classique qui prend alors le pas sur le Baroque.
Wolfgang Amadeus Mozart lui-même ne faisait pas exception, jusqu'à ce jour de 1782 (Mozart a alors 26 ans) où le baron Van Swieten, un passionné de musique baroque qui possédait une bibliothèque musicale très riche, lui fit découvrir avec enthousiasme une partie de l'œuvre de Bach et les Oratorios de Haendel.
Ce fut un cas assez exceptionnel de rencontre entre deux génies, l'un ayant nombre de secrets à apprendre de l'autre. Pour Mozart, qui était alors le plus grand compositeur vivant, et qui se trouva brutalement confronté, non à un confrère réputé, mais à un maître écrasant, le choc fut rude. Il réussit à assimiler cet immense héritage, son écriture en fut changée, et les connaissances acquises se retrouvent dans son œuvre. On pense notamment au Requiem, à la symphonie « Jupiter », dont le quatrième mouvement est une combinaison de forme sonate et de fugue à cinq voix écrite en contrepoint renversable, à certains passages de La Flûte enchantée, etc.
Ludwig van Beethoven connaissait très bien l'œuvre pour clavecin de Bach et, jeune, il en jouait une grande partie par cœur. Il a pris exemple sur les Variations Goldberg pour composer ses Variations pour piano. Vers la fin de sa vie, Beethoven étudia aussi la grande Messe en si mineur du Cantor de Leipzig. Ainsi, Beethoven s'inspirera de l'art du contrepoint de Bach pour composer sa Missa Solemnis, œuvre dont il parlait comme étant « sa plus grande ».
Ce n'est qu'en 1829 que Mendelssohn, l'un des successeurs de Bach à Saint Thomas de Leipzig, fit rejouer la Passion selon Saint Matthieu à l'Église Saint Thomas. Il permit ainsi de redécouvrir, au XIXe siècle, le génie du compositeur oublié. Les romantiques, d'abord allemands, ont alors repris cet héritage, en l'adaptant aux goûts du XIXe siècle, et particulièrement Brahms à Vienne. Même le "Tristan et Isolde" de Wagner, où l'étude attentive de "L'Art de la Fugue" transparait (notamment dans le "Prélude"), montre l'influence de Bach. Schoenberg voit même en Bach un précurseur de ses théories, et même si l'on peut contester cette allégation, le novateur viennois a écrit sur Bach de passionnantes pages dans ses innombrables essais.
Depuis, son œuvre, insensible à l'évolution des goûts, reste la référence incontournable et inégalée de l'ensemble de la musique occidentale. Il semble même que l'enthousiasme gagne l'Asie, et particulièrement le Japon. Dans les années 1930 à Leipzig, une nouvelle approche de la lecture des œuvres de Bach va être initiée par Karl Straube avec des effectifs instrumentaux et choraux moins imposants que ceux des interprétations du XIXe siècle ; Straube va aussi jouer les œuvres dites théoriques comme L'art de la fugue (avec orchestre toutefois). L'aboutissement de ce « renouveau baroque » se retrouvera à partir des années 1950, avec des interprètes tels que Gustav Leonhardt et ses nombreux disciples, ou Nikolaus Harnoncourt. Gustav Leonhardt et Nikolaus Harnoncourt seront les premiers à enregistrer l'intégrale des cantates. On se doit également de citer John Eliot Gardiner, qui est depuis les années 70 à la tête du Monteverdi Choir et des English Baroque Soloists qu'il a créés. Il a réalisé en 2000 à l'occasion du 250e anniversaire de la mort de Bach une première mondiale : l'interprétation en concerts à travers le monde de l'intégralité des cantates sacrées (plus de 200 subsistent) au cours de l'année. Un des personnages les plus importants actuellement est bien sûr aussi Philippe Herreweghe, qui dirige l'orchestre de La Chapelle Royale et le Collegium Vocale à Gand. Harnoncourt, Leonhardt, Gardiner et Herreweghe sont parmi les chefs les plus appréciés pour la musique du Cantor de Leipzig, tant par la précision et la virtuosité technique que par richesse de l'interprétation et leur expressivité.
Glenn Gould révélera également tout le génie de Bach en mettant l'accent sur la sensibilité, ainsi que sur la rythmique, grâce à ses interprétations au piano. Glenn Gould arrivera à l'apogée de son alchimie musicale dans le deuxième enregistrement des Variations Goldberg en 1981.
Cette musique, même, revisitée (Jacques Loussier ou Wendy Carlos), transposée, voire utilisée comme standard de jazz, garde ses propriétés esthétiques, comme si la richesse de sa structure rendait le reste accessoire.
Marcel Dupré jouait l'œuvre intégrale de Bach pour orgue par cœur, de même que Helmut Walcha, le grand organiste allemand qui, aveugle dès son adolescence, l'apprit par une écoute attentive.
Citations
* «Le but de la musique devrait n’être que la gloire de Dieu et le délassement des âmes. Si l’on ne tient pas compte de cela, il ne s’agit plus de musique mais de nasillements et beuglements diaboliques.»
* «La musique : une harmonie agréable célébrant Dieu et les plaisirs permis de l’âme.»
* «J'ai beaucoup travaillé. Quiconque travaillera comme moi pourra faire ce que j'ai fait.»
Pensées sur Bach ...
* « Devant celui-là, tous les autres ne sont que des enfants », Robert Schumann ;
* « Sans Bach, la théologie serait dépourvue d'objet, la Création fictive, et le néant péremptoire », « S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu », Émil Michel Cioran, Syllogismes de l'amertume, Gallimard ;
* « La musique, chez Bach, tend à devenir un être vivant, palpitant et sensible », Pierre Vidal.
* « Il y a d'abord Bach … et puis tous les autres. » Pablo Casals
* « Malgré tout mon amour pour beaucoup d'autres – et Beethoven et Mozart ne sont pas les moindres – je ne peux qu'être d'accord avec Casals : Bach les domine tous. » Paul Tortelier
* « Une seule goutte de Bach vaut une citerne d’autre musique » Mstislav Rostropovitch
* « En tout art, de hauts génies dominent sur les autres, et semblent l'emporter sur toute beauté rivale: ainsi Shakespeare et Racine, Aristophane et Virgile, Goethe et Stendhal, Rembrandt ou Goya. Mais Bach me donne l'idée qu'il est plus grand, plus puissant, plus beau, plus étendu en musique, plus musical enfin qu'aucun autre artiste souverain dans son art propre. Et même la vertu de Bach est telle qu'il domine sur tous les artistes, en quelque art que ce soit, et non pas seulement dans le sien. » André Suarès, Pages
Les liens à écouter avant de voter 
:
Toccata et Fugue BWW 565
Concerto en Ré mineur, BWW 1052 par Glenn Gould
Prélude, suite BWW 1007, par Yo Yo Ma
***********************************************
Présentation des Rolling Stones :
Tiré de :
http://musique.fluctuat.net/the-rolling-stones.html
Le rock possède deux sortes de légendes. Il y a celles qui brûlent en plein vol : les musiciens qui meurent trop jeunes ou les groupes qui se séparent, laissant traîner derrière eux on ne sait quelles suppositions sur ce dont ils étaient capables. Et il y a ceux qui vieillissent, perdant le plus souvent la fougue de leurs primes années. Les Rolling Stones habitent un entre-deux plutôt inconfortable. Cités partout comme un des groupes les plus importants de l’histoire, ils ont leur mythologie tragique (celle de Brian Jones), mais sont aussi devenus les plus illustres papys du rock, poursuivant au 21ème siècle les tournées qu’ils faisaient déjà dans les années 60.
L’origine des Rolling Stones remonte à très précisément à 1960. Keith Richards et Mick Jagger sont deux adolescents de la petite bourgeoisie banlieusarde (Dartford), qui se désintéressent complètement de leur modèle familial. Mick boit pour oublier ses études d’Economie. Quant à Keith, il montre une inadaptation parfaite aux études, préférant jouer de la guitare en grillant ses premières cigarettes. Tous deux partagent une passion : le blues, dont ils collectionnent fiévreusement les disques, alors introuvables : Howlin’ Wolf, John Lee Hooker, Willy Dixon, BB King et bien sûr, Muddy Waters, auteur de la phrase : “I am a man/I’m a Rolling Stone” (“Mannish Boy”). S’ils apprécient le rock’n roll noir de Chuck Berry ou Bo Diddley, ils méprisent sans appel les premiers rockeurs anglais, Cliff Richard en tête et manifestent un intérêt très limité pour la musique d’Elvis Presley. Bref, ils sont déjà complètement à contre-courant.
Un jour de 1962, ils rencontrent dans un club un jeune guitariste nommé Brian Jones. Bien qu’il n’ait qu’un an de plus qu’eux, le jeune homme affirme avoir bien vécu, consomme déjà des drogues variées et s’invente une vie fabuleuse de hors-la-loi, avec des enfants illégitimes en Suède et plusieurs révoltes derrière lui. Surtout, c’est un érudit du blues, rompu au bottleneck. Les Rolling Stones naissent, bientôt rejoint par Ian Stewart au piano et, l’année suivante, Charlie Watts (batterie) et Bill Wyman (basse), qui remplace l’éphémère Dick Taylor, parti terminer ses études.
Dès 1963, les Stones découvrent une sorte de leader occulte en la personne d’Andrew « Long » Oldham. Agé de 19 ans, ce manager s’impose comme un digne héritier du Colonel, le fameux homme de main d’Elvis. Sentant que l’Angleterre s’ennuie ferme, il décide de faire des Stones un instrument sexy de provocation et d’agitation culturelle. Ian Stewart, avec son look de bon père de famille, reste dans le groupe mais se trouve écarté des photos officielles : une situation qu’il vivra, plus ou moins facilement, jusqu’à sa mort dans les années 80… Les cinq autres adoptent des poses, des mines et une attitude qui, quelques mois plus tard, deviendront l’étalon d’un certain rock’n roll. Deux 45 tours, (« Come On », signé Chuck Berry et « I Wanna Be Your Man », un titre de Lennon et MC Cartney), leur suffisent pour conquérir les télévisions européennes, les festivals de rythm’n blues et les radios. Partout, à Blackpool comme à Paris, leurs concerts déclenchent des émeutes miniature, où l’on casse tout ! Le groupe détrône alors Gene Vincent et Eddie Cochran dans le cœur des blousons noirs et devient le symbole d’une jeunesse rebelle, par opposition aux « gentils » Beatles.
Publiés en 1964, leurs deux premiers albums comportent les premières compositions signées Jagger/Richards. Mais le groupe brille toujours par ses reprises : « Not Fade Away », « Time Is On My Side », « It’s All Over Now »… Brian Jones est la figure central du groupe. Blond ténébreux et inquiétant, il reste le maître de ce répertoire et est au centre des orchestrations. Un nouveau son anglais se développe, que viennent défendre une flopée de nouveaux groupes partageant les mêmes passions : The Animals, The Moody Blues, The Yardbirds… Et les Stones se retrouvent naturellement au centre du mouvement !
Pourtant c’est l’année suivante qu’ils rentrent dans l’histoire. Avec la lugubre ballade « Heart Of Stone », Jagger et Richards montrent la pertinence et l’originalité de leurs compositions. Et dès lors, les faces A des 45 tours leur sont systématiquement confiées. Ce qui donnera, successivement, « The Last Time », « Play With Fire » et surtout, « Satisfaction », coup de génie redéfinissant en 3 minutes 45 les codes du rock. De nombreuses légendes courent sur ce morceau. Keith Richards aurait par exemple imaginé en rêve ce riff qui le structure du début à la fin. Toujours est-il qu’il frappe durablement l’imaginaire des adolescents : ses connotations à la fois sexuelles et politiques en fond un véritable hymne révolutionnaire. Et sa violence radicalise le rock, le détachant du blues et du swing dans lesquels le rock’n roll baignait jusqu’alors.
Les Rolling Stones ont ouvert une porte et le savent. Dans leurs 45 tours suivants, « Get Off Of My Cloud » (fin 1965) ou « 19th Nervous Breakdown » (début 1966), ils repoussent toujours plus loin les limites. Malgré leurs paroles d’une rare misogynie, ils s’imposent du même coup comme les idoles de millions de fans, fascinées par leur aspect ténébreux. Et, au même titre que Dylan ou les Beatles, ils méritent d’être considérés comme les porte-paroles d’une génération refusant les valeurs de ses parents. Dès 1965, une chanson comme « As Tears Go By » montre aussi une toute autre facette du tandem Jagger/Richards : cette tendre et nostalgique ballade, créée par Marianne Faithfull dans une version baroque, inaugure une sorte de discographie parallèle, que certains fans porteront au pinacle : « Ruby Tuesday », « She’s A Rainbow », « Dandelion »…
« Aftermath », en 1966, fait partie des disques qui préfigurent l’ère psychédélique. Entièrement composé de morceaux originaux, il marque l’apogée et le début du déclin de Brian Jones. Des morceaux comme « Paint It Black », « Under My Thumb », « Mother’s Little Helper » ou « Lady Jane » brillent par la nouveauté de leurs arrangements, maniant le sitar, le marimba ou le clavecin. Et Jones demeure l’étonnant multi-instrumentiste coordonnant ces innovations. Mais pour ce qui est du lyrisme sombre, Jagger et Richards sont désormais seuls sur leur piédestal, rejetant peu à peu tous les autres membres du groupe dans l’ombre. Malgré ses quelques faiblesses – une poignée de morceaux un peu yéyés – le disque est reconnu presque partout comme un chef d’œuvre. Et les Stones concluent l’année par un somptueux disque en public : « Got Live If You Want It ! ».
1967, année où explose le mouvement hippie, va marquer leur descente aux enfers. Après quelques 45 tours abrasifs, en particulier « Let’s Spend The Night Together » (censuré par la BBC) le groupe se retrouve pris dans la plupart des pièges de l’époque. Mick Jagger s’embarque avec Marianne Faithfull dans la pénible expédition organisée par les Beatles auprès de leur Maharishi. Et la drogue commence à miner sérieusement leur cohésion. Arrêtés à plusieurs reprises pour possession de divers produits illicites, Jagger et Richards n’échappent à la prison que grâce à un véritable mouvement de soutien populaire. Mais c’est surtout Brian Jones qui voit, jour après jour, sa santé se détériorer à vue d’œil. Après « We Love You », festif 45 tours immortalisant le verdict de leur procès, les séances de « Their Satanic Majesties Request » rentrent dans l’histoire pour leur climat chaotique. Souvent improvisé – et rarement enregistré avec l’ensemble du groupe – le disque est défendu par une partie de la presse, mais comporte peu de classiques ayant traversé le temps… même si « 2000 Light Years From Home » ou « She’s A Rainbow » ont une saveur particulièrement unique.
Le 45 tours « Jumpin’ Jack Flash » et l’album « Beggars Banquet » marquent la reprise en main du groupe par Jagger et Richards. Revenu à un son plus rock, les Stones enchaînent les titres rebelles : « Sympathy For The Devil », « Street Fighting Man », « Salt Of The Earth », bande-son parfaite d’une année politiquement chargée. Ni le blues, ni l’esprit expérimental ne sont abandonnés. Et leur nouveau dosage fait des étincelles. Mais Brian Jones semble ne pas voir tout cela. Dans le « Rolling Stones Rock’n Roll Circus », étonnant film réalisé la même année – où l’on croise John Lennon, Eric Clapton ou Jethro Tull – le guitariste apparaît comme un spectre au regard vide, rongé par l’alcool et les drogues dures.
La nouvelle de son exclusion et de sa mort, le 3 juillet 1969, se suivront de quelques mois. Et encore aujourd’hui, les circonstances de ce décès restent mal élucidées : si les hypothèses d’une overdose ou d’un suicide restent les plus probables, Keith Richards affirma à Nick Kent sa conviction qu’il s’agissait d’un assassinat (voir « L’Envers Du Rock »). Quoi qu’il en soit, « Let It Bleed », paru la même année, sonne comme un requiem. Plus sombre que le plus sombre de leurs précédents disques, il alterne les derniers accords de Jones et les premiers de Mick Taylor, guitar-hero appelé à le remplacer. Et de l’apocalyptique « Gimmie Shelter » au doux-amer « You Can’t Always Get What You Want », l’album donne au rock un nouveau lot de classique. La légende noire des Stones trouve un nouvel épisode la même année à Altamont : un spectateur se fait assassiner par le service d’ordre du groupe au beau milieu d’un de leur concert. Pour beaucoup, cette mort marque la fin du « Summer Of Love » et de la croyance naïve des hippies en la paix et l’amour universels.
Les Rolling Stones entament alors une nouvelle mue. Habitués à des tournées de plus en plus colossales, ils signent deux derniers classiques presque universellement reconnus : « Sticky Fingers » (1971) et le double « Exile On Main Street » (1972), marqué par la collaboration avec un autre grand maudit de la pop, Gram Parsons. Mais « Goat’s Head Soup » (1973) et « It’s Only Rock’n Roll » (1974) ne convainquent guère la critique, en dépit du tube « Angie » qui, contrairement ce qu’affirme à une légende tenace, n’a jamais été dédié à la femme de David Bowie.
Après deux années de silence, les Stones annoncent le départ de Mick Taylor et son remplacement définitif par Ron Wood, ancien soliste des Faces. Et dès lors, ils trouvent le rythme et le style qui leur convient encore actuellement. Glosant « Jumpin’ Jack Flash » à l’infini (avec une touche très parcimonieuse de soul, sur des albums comme « Some Girls » ou « Emotional Rescue »), ils sortent un tube de temps en temps (« Miss You », « Start Me Up »…) et des albums réguliers, descendus par la critique mais achetés par des centaines de milliers de fans. Surtout, ils restent les champions du monde de la super-tournée, attirant des millions de spectateurs venus voir un mythe de plus en plus perdu dans les brumes du temps.
Après la mort de Ian Stewart et le départ de Bill Wyman en 1991, les Rolling Stones n’ont pas connu d’évolution majeure de personnel (leurs remplaçants n’étant toujours pas considérés comme des membres du groupe…). Leur dernier opus, « A Bigger Band », date de 2005 et leur dernière tournée, de 2006…
Les liens à écouter avant de voter 
:
Start me Up
Brown Sugar
Bitch
*******************************************
Fin des votes
samedi 20 octobre à 12 heures.
Bonne écoute et bons votes

.